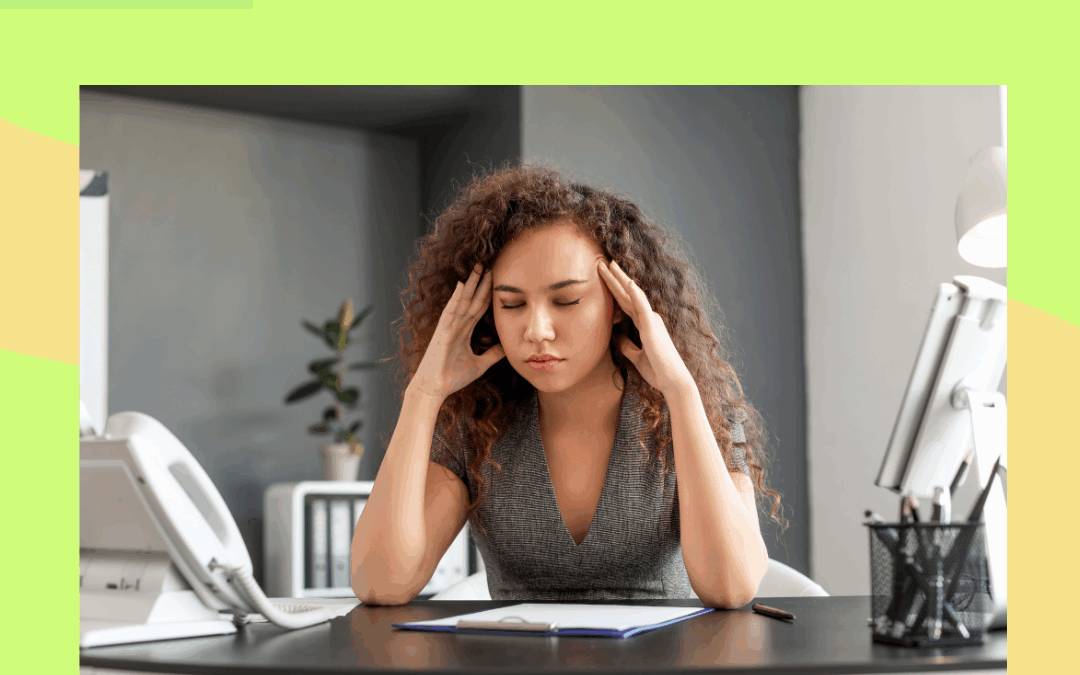La charge mentale : mieux comprendre sa complexité
La charge mentale est le poids invisible et constant de la planification, de l’organisation et de l’anticipation des tâches quotidiennes, qu’elles soient domestiques, professionnelles ou relationnelles.
C’est le fait de penser à tout, pour soi et pour les autres, générant une fatigue cognitive et émotionnelle souvent sous-estimée.
La charge mentale est un concept complexe qui nécessite une approche et une compréhension pluridisciplinaire.
Aujourd’hui, elle est abordée sous différents angles, notamment :
- Sociologique : cette discipline lui a donné sa première définition, notamment grâce aux travaux de Monique Haicault dans les années 70
- Psychologique : en particulier au travers de la psychologie cognitive et de la psychologie de la santé.
- Ergonomique : c’est une approche qui étudie la charge mentale de l’individu en interaction avec son environnement lors de la réalisation d’activités.
- Les sciences du travail.
- Et les études de genre c’est-à-dire les rôles sociaux attribués entre hommes et femmes.
Identification et nature de la charge mentale
Grâce à une approche scientifique combinant entretiens individuels et observations filmées, cette charge mentale a pu être identifiée initialement comme :
- Une forme de travail invisible c’est-à-dire un travail non reconnu, non valorisé et non rémunéré.
- Un poids fort inhérent majoritairement aux femmes concernant la gestion et l’organisation des activités de la vie du foyer.
Illustration : le quotidien de Sarah
Imaginons un instant le quotidien de cette jeune mère de famille que nous appellerons Sarah, mère de deux enfants, Lucie (8 ans), très active, et Tom (4 ans), son petit, qu’elle ne voit pas grandir. Elle est en couple avec Marc, cadre dynamique très occupé.
Tous deux travaillent à plein temps et sont passionnés par leur profession.
Mais du côté de Sarah tout n’est pas simple et reposant dès lors qu’elle est de retour à la maison !
Elle doit penser à cet email important à envoyer avant la fin de journée à ce client crucial, au risque de ne pas concrétiser ce contrat important à ses yeux.
Pendant qu’elle y pense, elle jette un œil à sa liste de courses qu’elle prévoit de faire avant la fermeture de son magasin de proximité. Elle songe que sa fille a un pique-nique le lendemain à l’école et qu’elle ne doit surtout pas oublier de lui prendre ce qu’il faut, sinon sa fille ne mangera pas le lendemain.
Du coin de l’œil elle regarde avec tendresse Tom, son fils, qui tousse de plus en plus…Il va sûrement falloir prendre un rendez-vous chez le pédiatre…
Quand elle entend Marc lui demander « On mange quoi ce soir, chérie ! » …
Sa charge mentale ne se voit pas, mais elle se passe dans sa tête, constamment.
De l’identification à la demande d’aide
Pour préserver son bien-être au quotidien, il me semble important de savoir quantifier sa charge mentale et de la détecter dans ses différents domaines de vie :
- Familial (comme nous l’avons vu pour Sarah),
- Professionnel ou dans le cadre des études lors de périodes intenses de travail notamment,
- Couple,
- Sphère sociale : avec ses amis.
En fonction du niveau de sa charge mentale, il devient important de savoir demander de l’aide à un tiers de confiance, qu’il fasse partie de son système relationnel proche ou qu’il soit une ressource plus neutre et éloignée.
Compétences clés mobilisées dans la charge mentale
Les études menées ont permis d’identifier l’ensemble des compétences impliquées dans la charge mentale :
- L’organisation et la prévision par la mise en place d’un système de règles dans le foyer
- La coordination et la réduction des tensions et désordres
- La faculté de mémorisation pour considérer les activités de chacun dans des temporalités différentes
- Les capacités de réponses aux imprévus
- L’empathie et la disponibilité affective, dit le « Care » ou soin. Elle définit le souci des autres, les relations à autrui visant à leur bien-être
Une prise de conscience grandissante
Il apparait que la charge mentale mobilise à la fois des dimensions organisationnelles et émotionnelles fortes.
La prise de conscience de la charge mentale a pu être faite il y a une dizaine d’années, notamment par la parution de la bande dessinée « Fallait demander » d’Emma, qui a largement contribué à populariser le concept auprès du grand public.
Si cette conscientisation a initialement mis en lumière les rapports sociaux de genre et les différences de perceptions entre hommes et femmes, il est aujourd’hui intéressant de constater que le concept de charge mentale résonne auprès d’un public beaucoup plus large.
On en parle désormais aussi bien concernant :
- Les femmes dans leur gestion du travail, du foyer, des enfants…
- Les hommes vis-à-vis de la pression dans leur cadre du travail, et aussi de leur charge parentale …
- Les couples dans leur gestion du rôle attendu de chacun, du temps disponible, de leur charge financière …
- Les parents, touchant aussi bien les femmes que les hommes, par rapport à la sécurité et au bien-être de leurs enfants, une logistique incessante, une charge organisationnelle et émotionnelle…
- Les étudiants vis-à-vis de la pression pour réussir, pour une performance, pour une gestion de vie autonome, avec une planification à respecter…
- Les actifs, salariés ou indépendants, dans leur gestion de tâches multiples, leur adaptation, leur charge émotionnelle associée au monde du travail, la gestion de leur carrière et de son évolution…
Au final nous sommes tous concernés.
Dès lors qu’une charge additionnelle s’impose dans notre « système » d’activités, de relations, de modes de fonctionnement : il est question d’une nouvelle réorganisation nécessaire.
C’est cette nécessité constante d’ajustement et de gestion mentale qui caractérise la charge mentale.
Et vous, arrivez-vous à mesurer votre charge mentale ? A faire la part des choses ? A prendre du recul par rapport aux situations vécues ?
Savez-vous gérer votre charge mentale pour réussir à l’alléger quand cela s’avère nécessaire ?
Rejoignez ma communauté, on en parle ensemble !
Source de référence : https://hal.science/hal-02881589/document