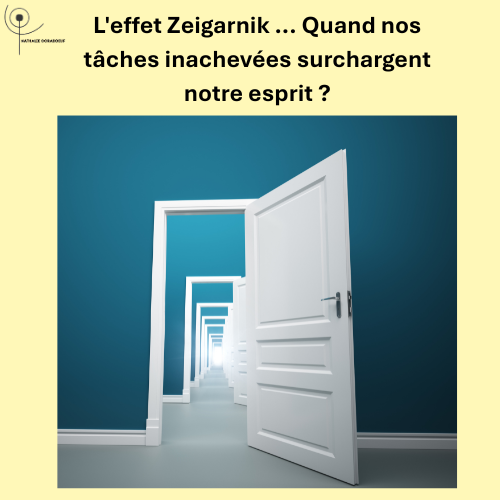Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation d’être mentalement submergé.e, comme si votre cerveau était une application de messagerie avec une centaine de notifications non lues ?
Cette semaine, je vous propose d’explorer un phénomène que je trouve très intéressant à relier à la sensation de surcharge mentale : l’effet Zeigarnik.
Loin d’être une simple anecdote, c’est un mécanisme psychologique puissant qui influence notre mémoire, notre motivation et même notre bien-être.
Mais qui était Bluma Zeigarnik ?
Avant de plonger dans les explications de cet effet, il est essentiel de présenter la femme qui lui a donné son nom : Bluma Zeigarnik (1900-1988), une psychologue lituanienne au parcours impressionnant.
Elle a grandi dans une période de bouleversements intellectuels majeurs en Europe, où la psychologie se structurait en une discipline scientifique à part entière. Elle a eu la chance d’étudier sous l’égide du psychologue germano-américain Kurt Lewin (1890-1947), considéré comme l’un des pères de la psychologie sociale moderne.
En 1924, lors d’un séminaire de Kurt Lewin à l’université de Berlin, elle observe un phénomène curieux : lors d’un dîner des serveurs semblent se souvenir parfaitement de commandes non encore payées, mais oublient presque instantanément celles qui ont été réglées.
Intriguée, elle décide de transformer cette observation informelle en une véritable expérience scientifique, marquant le début de ses recherches pour sa thèse.
L’expérience fondatrice : mieux retenir ce qui n’est pas fini
En 1927, dans le cadre de ses recherches, Bluma Zeigarnik mène une expérience devenue célèbre dans l’histoire de la psychologie.
Elle a recruté des participants et leur a demandé de réaliser une série de tâches, telles que résoudre des puzzles, dessiner, ou créer des objets à partir de perles, dans un temps limité.
La subtilité de l’expérience résidait dans le fait que la moitié des tâches étaient volontairement interrompues avant d’être terminées.
Une fois l’exercice achevé, elle demandait alors aux participants d’énumérer toutes les tâches dont ils se souvenaient.
Le résultat a été sans appel : les participants retenaient bien plus souvent les tâches inachevées que les tâches finalisées.
Bluma Zeigarnik a alors émis l’hypothèse qu’une tension émotionnelle interne, une sorte de « quasi-besoin » comme l’appelait Kurt Lewin, se crée lorsque nous commençons une tâche.
Tant que celle-ci n’est pas achevée, cette tension persiste, maintenant la tâche dans notre mémoire, autrement appelée notre « boucle d’inachèvement« .
L’achèvement de la tâche agit comme une résolution de cette tension, permettant à notre cerveau de « décharger » cette information et de la reléguer à un plan moins conscient.
Ce serait un peu comme un programme en arrière-plan sur votre ordinateur qui consomme des ressources jusqu’à ce que vous le fermiez complètement.
Les conditions d’apparition et les exceptions
Bien que l’effet Zeigarnik soit un concept général, il ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les situations.
Des recherches ultérieures ont permis de définir des conditions spécifiques qui influencent sa puissance :
- L’implication personnelle : l’effet est ainsi d’autant plus fort que la personne est profondément impliquée et motivée par la tâche.
Si une tâche est perçue comme insignifiante ou sans intérêt, l’interruption aura peu d’impact.
- La clarté de la fin : pour que la « boucle » se forme, le cerveau doit percevoir que la tâche est réalisable et qu’elle aura une fin claire et définie.
Si l’objectif est trop flou ou le projet semble sans fin, l’effet peut être atténué.
À l’inverse, l’effet Zeigarnik semble s’estomper dans certaines circonstances.
Par exemple, si la personne est trop fatiguée, si un épisode émotionnel fort vient perturber son attention, ou si elle juge la tâche trop difficile pour être accomplie.
De même, si la personne trouve une action de substitution pour atteindre le même objectif, la tension de l’inachèvement peut être réduite.
Enfin, si le temps écoulé depuis l’interruption est trop long, le cerveau finit par relâcher la tension associée.
Il est important de noter que la puissance de l’effet peut aussi varier selon la personnalité.
Des études ont montré que les personnes ayant un fort désir de bien faire, ou dont l’ego est sensible aux critiques d’inachèvement, ressentent cet effet de manière plus intense.
Cela suggère que notre tendance à « boucler » les tâches non finies est profondément liée à notre quête de complétude et à notre estime de soi.
L’effet Zeigarnik et la surcharge mentale au quotidien
Alors, quel est le rapport entre cette expérience des années 1920 et notre quotidien moderne, souvent marqué par un sentiment d’urgence et de trop plein ?
La connexion est plus forte qu’on ne le pense.
Notre vie est un enchaînement ininterrompu de tâches : payer une facture, répondre à un e-mail important, commencer à préparer un rapport, appeler un ami, faire une course…
Autant de « boucles » qui s’ouvrent, et que nous n’avons pas toujours le temps de fermer. Chacune de ces tâches inachevées reste active dans notre mémoire, créant une tension qui, accumulée, peut mener à une véritable surcharge mentale.
Ce sentiment d’avoir le cerveau en ébullition n’est pas une simple impression, c’est le résultat concret de l’effet Zeigarnik en action.
Notre cerveau, programmé pour finaliser ce qu’il commence, nous envoie des signaux constants pour nous rappeler ces tâches en suspens.
Comment utiliser l’effet Zeigarnik à notre avantage ?
Heureusement, comprendre ce mécanisme nous donne des clés pour mieux nous organiser et alléger cette pression mentale.
Plutôt que de subir passivement cet effet, nous pouvons l’utiliser comme un levier de productivité et de bien-être.
Terminer ce que vous commencez :
C’est le conseil le plus évident, mais aussi le plus efficace. Dans la mesure du possible, essayez de finaliser une tâche avant d’en commencer une autre. Si vous devez l’interrompre, essayez de le faire à un moment logique, en évitant le démarrage de cette action ou bien le milieu d’une action complexe.
Définir des tâches précises et délimitées :
Plutôt que de se fixer un objectif flou comme « travailler sur mon rapport », il est plus efficace de définir des actions concrètes et claires : »rédiger l’introduction du rapport » ou « rechercher les trois premières données clés ».
Le fait de pouvoir « cocher » une étape précise permet de clore une boucle et de réduire la tension.
C’est un principe que l’on retrouve d’ailleurs dans de nombreuses méthodes de gestion de projet et de coaching. N’hésitez donc pas à découper vos projets en séquences claires.
Libérer votre cerveau :
Si une tâche doit rester inachevée, notez-la quelque part.
Le fait de l’écrire sur une liste, un agenda ou une application de gestion de tâches peut suffire à convaincre votre cerveau qu’il n’a plus besoin de la retenir et ainsi le soulager.
Cette action symbolique de « décharge » de la tâche de votre mémoire est un moyen puissant de réduire l’effet Zeigarnik.
Et vous, l’avez-vous déjà ressenti ?
Maintenant que vous connaissez l’effet Zeigarnik, vous ne le verrez plus jamais de la même manière.
La prochaine fois que vous ressentirez cette frustration d’avoir des millions de choses en tête, demandez-vous :
- Ai-je été interrompu.e au milieu d’une tâche importante ?
- Est-ce que j’ai trop de « boucles d’inachèvement » ouvertes en même temps ?
- Comment puis-je clore ces boucles pour me sentir plus léger.e ?
N’hésitez pas à partager vos expériences pour voir comment cet effet influence votre vie professionnelle et personnelle.